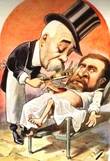Jouez-vous
aux dés
avec votre
santé?

Avantages et
inconvénients
d'un traitement
Clémenceau

Affronter la maladie main dans la main
L'information sur
les traitements que l'on vous propose, du simple médicament
à l'intervention chirurgicale, doit être complète.
Les litiges augmentent proportionnellement à la facilité
avec laquelle on se fait maintenant soigner. Il y a beaucoup plus de traitements
qui relèvent du confort: du calmant pris pour une douleur pas si
insupportable que ça à l'opération de chirurgie esthétique.
Il paraîtrait logique que le médecin insiste d'autant plus
sur les complications possibles que le traitement n'est pas indispensable:
inutile d'effrayer trop quelqu'un dont l'opération des coronaires
est vraiment nécessaire. Insistons plutôt sur les risques
d'un lifting ou de l'ablation de nodules disgracieux aux doigts: vous
jouez un peu au poker avec votre santé. Entre les deux, le remplacement
d'une hanche ou d'un genou complètement usé n'est pas obligatoire,
mais n'est plus seulement du confort quand les douleurs conduisent à
une perte complète d'autonomie. Il faut juger au cas par cas.
Malheureusement, dans la pratique, ces notions de bon sens sont encadrées
par des lois rigides: la jurisprudence se fait unanime: en cas de résultat
non conforme, le médecin doit démontrer qu'il a bien informé
son patient de tous les risques possibles du traitement proposé.
En clair: il doit vous faire signer un papier attestant que vous êtes
prévenu que le médicament prescrit peut provoquer un choc
allergique (presque tous), une somnolence susceptible de provoquer un
accident sur la route (décontractants, anti-douleurs), une insuffisance
rénale aiguë, une hépatite mortelle... En chirurgie,
il faut accepter de courir les risques des multiples causes de décès,
les infections, mutilations, séquelles irréversibles. Rassemblez
votre courage pour avaler la pilule ou vous soumettre au bistouri!
Si ces obligations étaient strictement respectées, l'avantage
serait de limiter le recours trop facile aux médicaments. Mais
à l'opposé nombreux seraient ceux qui refuseraient de prendre
un traitement ayant pourtant pour eux bien plus d'avantages que d'inconvénients.
Il faut laisser de l'espace à la confiance mutuelle qui permet
au médecin de conseiller son patient, ne rien cacher à celui
qui veut tout savoir, tempérer l'enthousiasme de ceux qui espèrent
trop des traitements proposés, mais ne pas paniquer ceux qui ont
tout intérêt à se faire soigner.
Plus l'indication de traiter n'est pas formelle, plus le patient est à
même de peser le pour et le contre, plus il doit participer à
la décision finale, éventuellement sa famille avec lui.
Mais il n'est pas bon de faire peser toute la responsabilité sur
le principal intéressé. A l'extrême, cela pourrait
devenir: "Vous faîtes le traitement X, vous y gagnez: a)...,
b)..., c)...; vous risquez: 1)..., 2)..., 3)... Maintenant, entourez votre
réponse: OUI - NON". L'expérience du médecin
traitant n'est pas remplaçable: c'est lui qui peut estimer au mieux
ce que vous risquez: il connaît la fréquence et la gravité
des complications encourues, de la maladie et de son traitement, il connaît
la compétence du confrère à qui il vous confie éventuellement.
Il doit dans certains cas se débarrasser d'une tendance à
banaliser certains traitements; d'autres fois, c'est au contraire une
réticence injustifiée vis à vis de nouveaux traitements
qu'il doit vaincre. Dans les situations délicates à trancher,
il est parfaitement justifié de prendre un avis supplémentaire.
De moins en moins de médecins s'en formalisent, et ce ne sont pas
des consultations supplémentaires qui mettront l'assurance-maladie
dans le rouge, surtout si elles évitent des interventions inutiles.
Il faut donc souhaiter qu'en cas de litige la justice sanctionne plutôt
le défaut d'objectivité du thérapeute que le défaut
d'information. La dérive qu'elle peut entraîner est nette
aux Etats-Unis, où patient et médecin se regardent en chiens
de faïence en se demandant lequel va causer des ennuis à l'autre,
et où la consultation du généraliste démarre
à 80€ (500 Frs) parce qu'elle inclue de lourdes charges d'assurance
responsabilité professionnelle.
La loi votée récemment sur l'indemnisation de l'alea thérapeutique
rassure tout le monde: elle permet l'indemnisation des victimes d'accidents
sans faute médicale. Son inconvénient est qu'elle risque
de banaliser les traitements à risque, les médecins étant
rassurés de ne pas subir eux-mêmes les conséquences
des inévitables accidents qu'ils entraînent.![]()
Vous
prescrit-on un placebo?
Une situation éthiquement difficile se présente assez
souvent à votre médecin: doit-il vous prescrire un médicament
auquel il ne croit guère (placebo ou presque) s'il pense que le
fait d'avaler une pilule va vous faire néanmoins du bien? La situation
se présente quand vous espérez (réclamez?) qu'un
traitement efficace existe pour votre problème, et que ce n'est
pas le cas. Souvent la solution la plus simple pour le médecin
est de vous donner un médicament "gentil". Malheureusement
s'il n'y croît guère lui-même, vous le sentirez et
il n'a aucune chance de marcher. Même si les motifs sont erronés,
il vaut mieux avoir sincèrement foi dans son placebo pour être
un patamédecin efficace!
(détails sur le placebo)
L'autre approche, bien meilleure mais délicate et dévoreuse
de temps, est de mettre au clair les motifs de votre besoin de traitement:
le plus souvent l'inquiétude face au vieillissement et ses conséquences,
beaucoup plus sur les facultés intellectuelles que physiques. Voyez
le succès des placebos qui s'adressent directement aux effets du
vieillissement! Ce pas difficile étant franchi, il vaut mieux que
votre médecin ne vous laisse pas en plan sur ce constat, sinon
vous pourrez lui en vouloir! Il montrera suffisamment d'empathie pour
vous aider à comprendre que la vie n'est pas terminée, qu'il
faut chercher de nouveaux motifs de satisfaction personnelle, qu'il y
a des conflits qui vous pourrissent depuis longtemps la vie et pour lesquels
il serait temps d'essayer une nouvelle approche. S'il fait tout cela en
une seule consultation, n'hésitez pas à lui régler
un dépassement d'honoraires! Dites-vous enfin que si vous êtes
là pour trouver des réponses à vos questions, c'est
que votre enthousiasme pour la vie est toujours là. Il n'y a pas
de solution à tout, mais le non-dit est bien pire. Les médecins
ont davantage de motifs de désespérance avec ceux qui ont
déjà mis dans leur fort intérieur un pied dans la
tombe.
Vous devez connaître ce mécanisme important de la relation
médecin-malade. Sinon, par connivence tacite à ne pas pousser
les choses plus loin, vous vous retrouvez rapidement avec une "pancarte
chargée" (allusion à la pancarte du lit d'hôpital
sur laquelle le professeur vient biffer parfois 9 sur 10 des médicaments
pris en ville, pour leur caractère "facultatif"). Osez
demander à votre médecin s'il pense indispensable ce nouveau
traitement. Paradoxalement ayez plutôt confiance dans ceux susceptibles
de vous causer des ennuis: si le médecin vous conseille de courir
ces risques, c'est qu'il pense que votre maladie est potentiellement beaucoup
plus dangereuse. Il n'a aucun intérêt personnel à
vous faire avaler ces pilules. C'est vrai qu'il existe une pression des
industries pharmaceutiques à banaliser l'usage du médicament,
qui vous touche autant que les médecins par l'intermédiaire
des médias remplis de publi-information. Mais l'action des laboratoires
auprès des médecins vise moins à augmenter le volume
des prescriptions qu'à favoriser leur produit par rapport aux concurrents,
dans des indications dont les médecins gardent le contrôle
dans la majorité des cas. Ne sortez pas déboussolés
de cette lecture: gardez confiance en l'indépendance d'esprit de
votre médecin. Et pour les traitements délicats ou prolongés,
prenez éventuellement un autre avis. Un avis compétent,
pas celui de votre voisin ou de l'horoscope.![]()
La
vérité au malade
Faut-il tout dire au malade de sa maladie? Grand débat. Difficile
d'instituer des règles. La seule est de dire tout à celui
qui l'exige vraiment. Le libre arbitre est une chose importante. Mais
combien de fois un médecin entend-il la question "Dîtes-moi
la vérité" alors que la vraie demande est "Rassurez-moi,
docteur"...
Quelques éléments de réflexion:
Le médecin doit parler de ce qui est compréhensible pour
vous. Détaillez les aspects techniques de votre maladie et surtout
des difficultés techniques qui peuvent être rencontrées
n'a pas beaucoup d'intérêt quand vous êtes largué,
sinon de générer une angoisse supplémentaire. Il
faut toujours être dans le dialogue, pas le monologue technique.
Votre origine culturelle est très importante. Pour des motifs culturels
et religieux, votre fatalisme peut varier grandement. Le fatalisme des
anglo-saxons est supérieur à celui des latins, celui des
orientaux supérieur à celui des occidentaux. Le malade anglo-saxon
se voit ainsi facilement annoncer un temps de vie précis restant
par son médecin, ce qui est rare dans les pays latins.
En France, la tendance générale est d'annoncer les diagnostics
graves à la famille plutôt qu'au malade. Certaines des raisons
sont bonnes: si le médecin ne connaît pas bien son patient
(à l'hôpital), il peut éviter un mauvais choix psychologique:
certains sont "cassés" définitivement par l'annonce
d'un diagnostic grave et vont passer leur fin de vie en déprime
permanente. La plupart des raisons sont mauvaises: peur de servir de bouc
émissaire ou d'indiquer implicitement un bouc émissaire
(le médecin qui n'a pas fait immédiatement le diagnostic?),
recul devant la prise en charge psychologique qui doit normalement s'associer
à une telle annonce.
Le principal défaut de notre système est l'absence de codification
des maladies. On comprend facilement qu'une opération soit facturée
plus ou moins chère selon la gravité et le temps passé
par le chirurgien. Ce n'est pas le cas pour la consultation médicale,
ce qui incite théoriquement le médecin à préférer
s'occuper des problèmes légers, pas ceux qui demandent beaucoup
de discussion et d'entourage. La journée du médecin est
déjà longue.
La prise en charge psychologique d'une annonce grave est indispensable.
Les familles sont rarement en état de s'en occuper seules. Mais
elles ne doivent pas démissionner. Leur participation est essentielle.
Le système de santé ne peut pas tout prendre en charge,
ou cela se fera au détriment de la recherche et de l'amélioration
des progrès techniques dans ces maladies. Son rôle est d'éduquer
et de conseiller. On ne peut pas fonctionnariser une prise en charge psychologique.
Les associations de bénévoles ont un rôle essentiel.
Elles ne devraient pas prendre l'allure d'administrations, pour ne pas
décourager ces bonnes volontés. Chacun doit lutter contre
l'égoïsme ambiant par une action locale, auprès des
gens qu'il connaît. Une comparaison: la mendicité a pris
une dimension industrielle dans les grandes villes, ce qui n'incite guère
à participer, alors que l'on se laisse facilement apitoyer par
le galérien qui habite près de chez soi. Il ne faut pas
que l'entraide psychologique prenne le même chemin. Que l'on aie
pour seul conseil à celui qui est dans les ennuis: "Tu devrais
aller voir un psy". N'oublions pas que le meilleur antidépresseur
pour quelqu'un est de lui montrer notre sollicitude et notre affection.
Des dérives sont possibles, fréquentes même. Trop
cocoonés, certains malades ont tendance à profiter de la
situation. Comme pour tout comportement infantile, il faut tracer une
limite entre sollicitude et assistance/dépendance. Ne donnez pas
plus que vous n'êtes prêt à donner. Mais surtout expliquez.
Le non-dit est plus mortel qu'une bonne engueulade! ![]()
L'avenir
de la médecine de famille:
La perte des valeurs de la médecine de famille vient des contraintes
économiques. Pour continuer à connaître son patient
et son environnement en profondeur, le médecin doit disposer de
temps. 2 écueils: l'augmentation des besoins de santé très
supérieure au nombre de médecins, qui obligent ceux-ci à
passer de plus en plus de temps à leur cabinet et à réduire
le temps passé à chaque acte; et le blocage des honoraires
de consultation, qui n'incite pas à l'éterniser mais plutôt
à faire des actes techniques, plus rémunérateurs.
Vous constatez de façon éloquente que les médecins
à "mode d'exercice particulier" (homéopathes,
acupuncteurs, magnétiseurs, etc...), qui prennent davantage de
temps pour vous parler, sont tous en secteur 2 (honoraires libres). La
médecine "humaine" est actuellement à 2 vitesses.![]()
Le
médecin, vous et le coût de la santé
Votre médecin doit-il faire des économies pour vous
soigner? Sur un sujet aussi sensible, ce sont les attitudes extrémistes
qui doivent être évitées, dans le sens du gaspillage
comme dans celui de l'économie à outrance. Même entre
les médecins il y a des pommes de discorde, les hospitaliers accusant
les libéraux de prescriptions inutiles, les libéraux trouvant
démesurée (60%) la part de l'hôpital dans les dépenses
de santé par rapport au nombre de personnes soignées. On
s'émeut que tel nouveau traitement soit retardé ou tel examen
insuffisamment disponible (IRM) pour des motifs économiques, pourtant
l'augmentation des dépenses rend hystérique les ministères
concernés. Etonnant comme les avis divergent entre le professionnel
de santé, l'économiste, le quidam moyen qui a ou n'a pas
tâté du système de santé. Cela s'explique en
une petite phrase: la France n'a aucune politique de la santé.
Cela dure depuis longtemps et n'est pas prêt de changer. Les historiens
nous l'expliquent, cette démission remonte à la Révolution
Française, où une première tentative maladroite de
régenter la santé a engendré un tel chaos que nos
gouvernants n'ont plus jamais voulu s'y frotter. Les mandarins ont longtemps
régné à l'hôpital sans être gestionnaires,
les libéraux ont longtemps protégé leur liberté
grâce à leurs patients hauts placés et à l'estime
populaire, l'homme de la rue s'est battu pour que le droit à la
santé devienne le même pour tous, mais y cherche maintenant
d'autres avantages sociaux. Le ministre fait en apparence son boulot,
relâche d'un cran la ceinture des dépenses, mais elle pète
quand même chaque année!! Actuellement, nos gouvernants sentent
un tel septicisme de toutes parts quand ils parlent de réforme
de la santé qu'ils n'osent bouger.
Pourquoi faut-il éviter de prescrire un examen inutile? La réponse
vous paraît facile. Mais pourquoi faut-il aussi éviter de
prescrire un examen peu utile? Plus délicat. C'est pourtant nécessaire
car nous sommes dans un budget fermé de la santé: tout le
monde s'accorde que ce budget doit rester dans certaines limites, sinon
ce sont d'autres comptes sociaux du pays qui risquent d'en pâtir.
Si l'on effectue une dépense peu utile, c'est au détriment
d'une plus utile. Ainsi on peut affirmer que les examens de sang, radios
et scanners pratiqués sans grande justification ont été
en partie responsables de notre retard catastrophique d'équipement
en IRM. On ne peut avoir d'argent pour tout. 2 autres conséquences
plus pernicieuses: 1) Les examens peu utiles ont une certaine morbidité:
radios et scanners irradient, les injections peuvent déclencher
des allergies, les explorations invasives (fibroscopie) toutes sortes
d'ennuis jusqu'au décès. Les examens peu utiles découvrant
par définition rarement quelque chose, quel est leur bénéfice
en tenant compte de leur morbidité? Personne n'est capable de répondre,
mais la plupart des gens agissent comme s'il était criminel de
ne pas les pratiquer. 2) Quand un spécialiste pratique de nombreux
examens qui s'avèrent normaux, il est forcément moins attentif
que si chaque cas est un excellent motif, le risque d'erreur augmente.
La médecine est encore suffisamment un art pour être dégradée
par les pratiques industrielles.
Qui est responsable du gaspillage? Le patient, le médecin? La faute
doit-elle retomber sur l'économiste, qui ne veut pas délier
les cordons de la bourse?
Tout le monde est responsable, en fonction de sa position de client ou
de prescripteur du système, et de son degré de moralité
personnel.
Le patient est responsable quand il pousse son médecin à
faire un examen "pour voir", ou un traitement "pour faire
quelque chose". Il a ses raisons: la maladie se médiatise
en un loup chaque jour plus affamé (3 cas d'encéphalite
spongiforme terrorisent 55 millions de personnes, qui ont bien plus de
chances de mourir d'un accident domestique), les erreurs médicales
se médiatisent aussi (ne va-t-il pas oublier quelque chose?), l'examen
clinique du médecin paraît de plus en plus rapide et lui-même
plus dépendant de tous ses chiffres et comptes-rendus. Comment
désormais confier facilement son sort à des mains qui semblent
plus habituées à manier le stylo ou à taper sur un
clavier? Si le médecin ne vous prescrit pas l'examen que vous attendez,
personne ne devrait plus hésiter à lui en demander la raison.
Les pratriciens campés dans l'idée que vous ne pouvez rien
y comprendre sont en voie de disparition. Ne tombez pas dans l'excès
inverse de tout vouloir savoir sur tout: vous n'étiez sans doute
pas tout seul dans la salle d'attente... Si la raison n'est pas convaincante
et que la situation vous angoisse beaucoup, ce n'est pas immoral de consulter
un autre médecin pour lui demander son avis sur l'examen que vous
pensiez nécessaire. Mais celui qui est ancré dans son idée
et cherche juste un prescripteur plus conciliant... A chacun sa spécialité.
Ce n'est pas parce que l'on est concerné de près que l'on
peut mieux identifier la maladie dont on souffre. Les médecins
vous le confirmeront, eux qui font souvent sur eux-mêmes leurs plus
belles erreurs de diagnostic, quand ils ne veulent pas embêter un
confrère.
Le médecin est souvent responsable de prescriptions peu utiles
par manque d'assurance, sa formation n'étant pas bien à
jour sur tout. Huit ans d'études pourtant, onze minimum pour les
spécialistes, il est vrai que cette formation n'est pas orientée
vers la pratique de la médecine libérale mais hospitalière.
De toute façon la médecine évolue tellement vite
que la formation doit rester permanente: c'est la formation médicale
continue (FMC). La profession essaye d'y pousser l'ensemble des praticiens,
mais la FMC se fait en ordre dispersé puisqu'actuellement chacun
est libre de s'y coller ou non. 2 écueils principaux: valorisation
purement personnelle apportée par ces formations (les médecins
ont pour la plupart déjà suffisamment, voire trop, de clients),
nécessité de temps alors que les consultations en absorbent
déjà beaucoup.
Le médecin peut prescrire des examens inutiles dans 2 autres circonstances
fréquentes: Il a peur de ne pas satisfaire son patient et de le
perdre, en ces temps de fort nomadisme médical. C'est une situation
fréquente dans les zones de trop forte densité médicale
(région parisienne, grandes agglomérations, sud-est). Sans
remettre en cause la liberté d'installation, il faudrait interdire
les nouvelles implantations dans les zones "surbookées",
comme cela se pratique déjà ailleurs. Autre circonstance
litigieuse: le médecin prescrit un examen d'utilité limite
pour multiplier les consultations (et les raccourcir). Par exemple vous
avez mal au dos et apportez une radio vieille de 3 ans. Elle oscille facilement
entre "assez récente" et "un peu ancienne"
selon le contexte. Enfin, les plus mauvaises langues signaleront que certains
médecins font travailler facilement les autres, mais cela reste
marginal parmi les autres travers signalés. Les médecins
ont aussi leurs raisons: Le tarif conventionnel dont ils sont prisonniers
n'a pas bougé depuis 8 ans. Ce sont les actes techniques qui sont
favorisés, pas l'acte intellectuel de la consultation. Les conséquences
sont claires: cela ne les incite pas à discuter et à palper
en détail mais à multiplier les consultations brèves
avec prescription d'examens complémentaires pour pallier à
la réduction de l'examen clinique du malade. Cela les incite également
à préférer les maladies simples aux problèmes
compliqués: une tendinite simple est bien plus "rentable"
qu'un problème de dos évoluant depuis vingt ans.
Ce sont les dysfonctionnements qu'entraînent l'absence d'une véritable
politique de santé.
Que devrait être cette politique dans une démocratie? Voici
notre prétentieuse opinion:
Pour satisfaire les économistes, il faut un budget pour la santé.
A l'échelle d'un pays, on ne peut pas se soigner à prix
d'or si on en n'a pas les moyens. Ce budget devrait donc être influencé
à la fois par la conjoncture économique générale
et par les grands indicateurs de l'état de santé de la population.
Quoi faire de ce budget? Il faut bien différencier ce qui relève
véritablement de la solidarité, et le "surplus".
La solidarité doit prendre en charge sans restriction les maladies
aléatoires qui rendent inégaux nos parcours dans la vie
et en abrègent parfois beaucoup certains: ce sont la plupart des
maladies courantes, de la virose bénigne au cancer malin. Le problème
des maladies auto-déclenchées ou auto-entretenues est un
cas à part. Il s'agit des situations "d'autolyse", où
une personne sait qu'elle se détériore la santé par
une pratique néfaste, qu'elle poursuit néanmoins. Nos voisins
anglais ont déjà eu des réactions spectaculaires
en refusant la prise en charge de certaines de ces maladies. Notre sensibilité
est différente sur le sujet. Mais cela pourrait faire l'objet d'un
débat public. Ces maladies prévisibles relève-t-elle
autant de la solidarité que les autres? Sachant que la plupart
de ces conduites d'autolyse relèvent de problèmes personnels,
ne faudrait-il pas mettre en place des incitations à entreprendre
une psychothérapie ou rejoindre un groupe de discussion plutôt
qu'à prendre en charge aveuglément toutes les conséquences
de ces comportements?
Le "surplus", une fois que les dépenses de solidarité
sont faites, sert actuellement à prendre en charge: 1) les dépenses
de confort, 2) les difficultés sociales, 3) la prévention
des maladies courantes. Leur intérêt est fort différent:
la prévention, c'est un investissement: la dépense ne produit
aucune amélioration de l'état de santé sur le moment
(campagne de vaccination, recherches sur une maladie médiocrement
traitée), mais la rentabilité est assurée par une
réduction future des maladies visées. Les difficultés
sociales sont largement prises en charge par l'assurance-maladie, de façon
tout à fait injustifiée. Nous ne parlons pas des cartes
santé et autres PMU qui permettent aux plus démunis de se
faire soigner gratuitement. Elles sont une grande avancée sociale,
et dans notre expérience l'immense majorité des bénéficiaires
n'en abuse pas. Nous parlons des arrêts de travail "limites"
ou carrément de complaisance, des accidents de travail interminables,
des congés de longue maladie et "invalidités"
remarquablement faciles à obtenir dans la fonction publique. Ces
abus sont causés majoritairement par des difficultés relationnelles
au travail. Notre propos n'est pas de nier les difficultés sociales.
Simplement elles ne relèvent pas de l'assurance-maladie. Elles
devraient être prises en charge par les organismes à vocation
strictement sociale. Que l'on sache exactement ce que coûte la santé.
Que l'on ne bloque pas les installations d'IRM parce que les dépenses
sociales grèvent les comptes de la sécu.
Les dépenses de confort ont des limites floues. On peut parler
de dépenses "non impératives". Elles ne comprennent
pas seulement les traitements légers type massages ou homéopathie.
De nombreuses opérations sont des opérations de confort.
Elles ne sont pas toutes remboursées. L'ostéopathie non
pratiquée par un médecin ne l'est pas. La prise en charge
de chacune de ces dépenses devrait être discutée.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un budget fermé et qu'elles empiètent
sur la prévention et les dépenses de solidarité indispensables.
Dans certains pays, les autorités ont mené des consultations
publiques pour savoir ce que les gens souhaitaient voir le mieux pris
en charge au niveau du confort: Voulez-vous qu'on rembourse mieux les
lunettes, les soins dentaires, la chirurgie esthétique, les manipulations
vertébrales, la sophrologie? Nous sentons que vous avez une opinion.
Peut-être serait-il judicieux effectivement que compte l'avis de
tous sur comment dépenser l'argent de tous, quand il s'agit de
dépenses non obligatoires... ![]()
Code
Déontologique du patient:
1. Ne tentez pas de convaincre votre médecin de votre souffrance.
Vous risquez de nuire à une précieuse objectivité
scientifique.
2. Soyez toujours gai devant votre médecin. Il mène une
vie agitée et stressante. Il a besoin de votre réconfort.
3. Essayez de souffrir des maladies pour lesquelles votre médecin
vous soigne. Il a une réputation professionnelle à soutenir.
4. Ne vous plaignez pas si le traitement n'apporte aucun soulagement.
Seul votre médecin sait ce qui est bon pour vous.
5. Ne questionnez jamais votre médecin sur ce qu'il fait. Il est
présomptueux de penser que ces choses peuvent vous être expliquées
en termes compréhensibles.
6. Soumettez-vous sans rechigner à tout traitement expérimental.
Même si ce traitement ne vous est pas bénéfique, la
publication des résultats sera d'un intérêt formidable.
7. Payez vos frais médicaux de bon coeur. C'est un privilège
de contribuer au bien être des professions médicales.
8. Ne souffrez pas d'affections trop chères pour vous. C'est arrogant
de contracter une affection au dessus de ses moyens.
9. Ne parlez jamais d'effets secondaires ou de faute. Vous abîmez
la relation médecin-patient, qui doit rester immaculée.
10. Ne mourrez jamais en présence de votre médecin. C'est
lui causer un embarras inutile.![]()
Dossier médical:
vos droits
Une loi récente (mars 02) vous autorise à accéder
à votre dossier médical. Vous pouvez faire la demande vous-même
ou passer par votre médecin habituel. Joignez un justificatif d'identité,
cela réduit les litiges et peut accélérer la procédure.
Précisez comment vous voulez accéder au dossier: consultation
sur place ou envoi du dossier à vous-même ou au médecin
qui vous représente. La demande peut s'adresser aussi bien à
une clinique, un hôpital, qu'à un médecin particulier.
Le délai d'obtention du dossier ne peut dépasser 8 jours
(2 mois pour les affaires remontant à plus de 5 ans). La consultation
sur place est gratuite, la copie des pièces est facturée
au prix coûtant, bon marché s'il s'agit de simples photocopies,
plus onéreuse si vous demandez la duplications des planches radiologiques.
Le délai de conservation du dossier est de 30 ans (délai
de prescription en matière de responsabilité).
Cas particuliers:
*Un mineur: seule une personne titulaire de l'autorité parentale
peut demander l'accès à son dossier, mais à condition
d'avoir son accord.
*Décès: 3 raisons légales permettent aux ayants-droit
du défunt de demander l'accès au dossier: connaître
les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt,
faire valoir leurs droits (auprès d'une assurance par exemple).
Le défunt peut s'être opposé de son vivant à
la communication d'informations: la demande sera rejetée. Un certificat
médical ne contenant pas de renseignements couverts par le secret
médical peut néanmoins être obtenu pour les assurances.
S'il n'y a pas eu opposition, seules les informations concernant le motif
précis de la demande sont communiquées et non l'intégralité
du dossier.
*Hospitalisation psychiatrique: la demande passe par une commission spécialisée
avant d'être acceptée.
Que doit contenir le dossier médical?
Pour un dossier d'hospitalisation, doivent obligatoirement figurer: fiche
d'identification du malade, motif d'hospitalisation et éventuelle
lettre du médecin adresseur, antécédents, résultat
de tous les examens pratiqués, fiche de consultation pré-anesthésique
et feuille de surveillance anesthésique, compte-rendu d'opération
ou d'accouchement, prescriptions de médicaments y compris l'ordonnance
de sortie, mention de transfusion éventuelle, dossier de soins
infirmiers, compte-rendu d'hospitalisation avec diagnostic final. Les
renseignements obtenus par des tiers (situation sociale, maladies dans
la famille) ne doivent pas figurer dans ce dossier, les "notes personnelles"
des médecins sont facultatives.
Si vous rencontrez de la mauvaise volonté, sachez qu'il n'y a pas
en réalité de sanctions prévues si le droit d'accès
au dossier n'est pas pas respecté. Mais en cas de procédure
contentieuse, les tribunaux jugeront sévèrement un médecin
ou un hôpital qui n'aurait pas rempli ses obligations. Vous pouvez
vous faire aider par une association, par exemple l'AVIAM Association
d'aide aux Victimes d'Accidents Médicaux 30 rue Léon Bourgeois
51000 Châlons en Champagne http://site.voila.fr/aviam.
Que faire de ce droit?
Cette loi est une bonne chose car elle fait disparaître une zone
d'ombre dans la relation de confiance entre les malades et leurs médecins.
Elle incitera à une tenue plus correcte de certains dossiers hospitaliers
"désertiques". L'usage de ce droit doit se faire cependant
avec intelligence. Vous avez toutes les chances de ne pas comprendre grand-chose
ou comprendre de travers un dossier livré brut à votre domicile.
Je souhaite que vous connaissiez un médecin franc et ouvert qui
servira de médiateur en cas de litige. La majorité des demandes
ne relève pas en effet de la simple curiosité! Il faut que
la vôtre aboutisse, mais que la procédure reste humaine...
et abordable. Il y a déjà en effet des médecins "experts"
dans l'assistance juridique des personnes lésées... à
des tarifs souvent exhorbitants. Les tribunaux tranchent ces litiges après
avis d'experts réputés dans le domaine concerné.
Vous aurez une idée assez précise du résultat en
prenant tout bêtement une consultation auprès d'un praticien
compétent sinon réputé. Il est clair que ce médecin
ne vous dira pas d'emblée qu'il y a eu faute médicale. Ce
n'est pas dans l'esprit confraternel. Cela peut paraître assimilable
à du corporatisme. Mais imaginez un monde où les médecins
s'auto-valoriseraient en cassant du sucre sur le dos des autres! Vous
ne sauriez véritablement plus à qui faire confiance. Généralement,
si vous posez clairement la question en précisant que vous avez
démarré une procédure contentieuse, vous aurez une
réponse. Cela peut vous éviter des démarches coûteuses
et parfois démoralisantes, le préjudice étant rarement
reconnu à la juste valeur de celui qui l'a subi. ![]()
Articles complémentaires réservés aux adhérents :
Vous avez déjà un code d'accès ? |
Vous n'avez pas de code d'accès ? |